English will follow
Souvent perçus comme enfermé.e.s dans leur tour d’ivoire et bénéficiant d’une présence minimale en salle de classe, les professeur.e.s universitaires font un travail mal connu et mal compris et même parfois dévalorisé. L’APPUSB propose une série de billets qui expliquent en quoi consistent les trois volets du travail de professeur : recherche, enseignement et service, dans l’objectif de mieux faire comprendre l’étendue du travail de professeur.e.s.
L’APPUSB est allée à la rencontre quelques professeur.e.s et professionnel.le.s enseignant.e.s de plusieurs disciplines (biologie, chimie, éducation, français, histoire, psychologie, travail social) pour mieux comprendre leur travail d’enseignement. Loin de constituer une étude exhaustive de tous ses membres, cet aperçu nous permet de saisir l’ensemble des tâches qui se cachent sous une simple charge d’enseignement.
Premier volet
L’enseignement universitaire : mythes et réalités
Mythe 1 : Les professeurs universitaires et les professionnel.le.s enseignant.e.s effectuent un travail qui prolonge le travail du secondaire, mais en plus compliqué.
Réalité : Un enseignement à la pointe du savoir
Contrairement au secondaire où le curriculum est établi par la province, les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s doivent monter les cours et même les programmes de toute pièce. En effet, c’est à chacun.e.s d’entre eux qu’il revient de déterminer entièrement la matière, les objectifs, le cadre et l’approche pédagogique de ses cours.
Cette liberté ne signifie pas que les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s se donnent tous les droits. La liberté académique, c’est-à-dire la garantie de l’absence d’interférences dans l’enseignement universitaire, est un privilège autant qu’une responsabilité, et c’est finalement l’obligation de se tenir à jour dans son expertise : «Ma discipline est un est un domaine de recherche très fertile où les connaissances évoluent rapidement,» nous confie un.e membre. « Souvent, il faut mettre le cours à jour, utiliser des exemples d’actualité. Il faut donc rester à jour dans le domaine, » explique une autre personne. Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s doivent constamment adapter le contenu du cours pour donner la formation la plus à jour possible aux étudiants.
Il existe une autre différence de taille entre l’enseignement universitaire et secondaire. « À mon avis, la formation à la recherche de nos étudiants est une partie intégrale des fonctions d’enseignement d’un professeur universitaire. » Ainsi, les cours au niveau universitaire n’offrent pas seulement un contenu qu’il faut comprendre et retenir. Ils forment les étudiants à un esprit critique et des habiletés pour les amener à se familiariser avec la recherche, que ce soient ses grandes écoles de pensée, les débats qui la divisent, les méthodologies diverses, les protocoles d’expérimentation ou la diffusion de ses résultats. Par exemple, ils apprennent à effectuer une recherche documentaire exhaustive et efficace dans les banques de données, à questionner la crédibilité des sources d’information, à développer leurs capacités d’analyse critique et leur capacité de synthèse, à établir un bon plan de rédaction, à rédiger dans un langage de nature académique, à présenter et défendre une proposition, etc.
Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s proposent aux étudiants tous les outils pour mieux comprendre, dans chacune de leur discipline, que la science est un savoir qui se construit, qui se dispute et qui se débat, souvent sur des décennies ou des centaines d’années. La formation universitaire se distingue de l’école secondaire parce qu’elle permet de se familiariser avec les processus de création et de transmission des savoirs que constitue la science et dont les habiletés permettent aux étudiants, à leur tour d’approcher leur métier avec un regard critique et d’innover dans le futur.
L’enseignement universitaire se place dans la mission d’une université, qui est de maintenir, de transmettre et de faire avancer le savoir.
Mythe 2 : Les professeurs universitaires et les professionnel.le.s enseignant.e.s travaillent peu parce qu’ils n’ont pas beaucoup de présence en classe.
Réalité : Une préparation et un suivi intensifs
Un cours de trois crédits comporte deux séances de 1h30 ou une séance de 3h chaque semaine, ce qui est en effet assez peu. Comme la charge d’enseignement normale est entre 18 et 21 crédits universitaires par an, chaque professeur.e et professionnel.le.s enseignant.e.s passe entre environ 9 et 11 heures en salle de classe par semaine.
Selon les disciplines, chaque cours d’une heure trente exige une préparation ponctuelle d’environ quatre heures, et cela ne tient compte ni de la mise sur pied des cours, ni des charges administratives afférentes au cours, ni des corrections.
En aval de chaque classe, il y a d’abord un travail de programmation, de création, d’administration ou de direction mené par les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s. En effet, ils héritent souvent de divers parcours de baccalauréat qu’ils doivent constamment adapter. En effet, puisque l’USB est rattachée à l’Université du Manitoba (UofM), les changements de leur côté ont un impact sur ceux de l’USB. De la même manière, les professeurs et les professionnel.le.s enseignant.e.s qui veulent renouveler entièrement l’offre de cours et le parcours menant vers la diplomation doivent le faire tout en respectant les critères imposés par UofM. «J’ai eu la tâche de présenter à mes collègues de l’Université du Manitoba les propositions des nouveaux cours et d’assurer auprès d’eux le suivi en vue de leur appui à la création de ces cours».
De plus, les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s doivent enseigner des matières qui sont assez loin de leur domaine de spécialisation, ce qui demande des lectures très conséquentes. En effet, ils ne se contentent pas de donner un enseignement minimal, mais doivent lire de manière extensive dans ce domaine pour être capables de distinguer ce qui importe et ce qui fait consensus, de ce qui est encore très disputé dans un domaine. Il faut d’abord maîtriser la matière pour être capable d’en faire une vulgarisation. Ce travail de préparation est intensif et il se multiplie pour les professeurs et les professionnel.le.s enseignant.e.s. « J’ai plusieurs collègues aux États-Unis qui enseignent plus d’heures en classe que moi. Mais, s’ils enseignent un 4-4 par exemple, ce sont systématiquement les mêmes cours chaque année et la plupart sont les mêmes cours enseignés en plusieurs sections. Je n’ai jamais encore rencontré de collègue en dehors de l’USB qui a dû préparer entre onze et douze nouvelles classes en l’espace de trois ou quatre ans,» explique un.e membre.
Un autre défi s’ajoute parce que certains cours ne sont enseignés que tous les deux ou trois ans. «On doit donc se réapproprier la matière à chaque fois et on doit mettre à jour la matière en fonction des recherches émergeantes dans le domaine.» Le processus de création et de mise à jour continuelle a un impact sur les autres aspects du travail de professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s. En effet, ceux qui enseignent une grande diversité de cours n’ont en fin de compte que très peu de moyens de mettre en évidence ce travail supplémentaire. Leur productivité sur le plan de la recherche et du service est souvent jugée au même niveau que des collègues dont la charge ou l’étendue de l’enseignement est moins conséquente.
En comptant la préparation, la mise à jour, la supervision et la correction, le temps consacré à l’enseignement pour une charge de 9 crédits par semaine s’échelonne entre 35 et 45h/semaine entre nos répondants. En fait, c’est un travail à temps complet qui nécessite des heures supplémentaires lors des périodes chargées de la session. Tout ceci évidemment, ne prend pas en compte de ce que l’enseignement ne constitue qu’une charge de travail sur les autres qui incombent aux professionnel.le.s enseignant.e.s et aux professeur.e.s. Pour les premier.e.s, ça peut être une charge d’enseignement supplémentaire en plus du service, et pour les second.e.s, le service et rien de moins que la recherche. Ce sont autant d’heures supplémentaires qui s’ajoutent à leur semaine.
Mythe 3 : L’enseignement universitaire est abstrait et inutile
Réalité : Un enseignement adapté pour la société d’aujourd’hui et de demain
Dans plusieurs disciplines universitaires, les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s ont à planifier des stages : la charge associée à la planification, au suivi et à la correction associée aux stages est conséquente. Les exigences varient d’une discipline à une autre mais la difficulté du stage se situe justement dans la nécessité de faire coïncider les intérêts d’un partenaire employeur avec les objectifs de formation de l’étudiant.e. Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s multiplient donc les correspondances, les contrats, les visites, les corrections et les accommodements pour répondre à toutes ces attentes. «Si tout va bien c’est minimum une visite mensuelle (trois heures), une rencontre de 30 minutes par semaine, la correction et rétroaction des travaux trois heures par semaine minimum par étudiant et ceci du mois d’aout jusqu’à la fin mars, » explique un.e membre. Un.e autre professeur.e surenchérit : «On n’est jamais complètement en vacances. Il faut toujours répondre aux étudiant.e.s et superviseurs de stage.» Il faut aussi noter que les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s ne sont pas uniquement chargés de créer une synergie entre les lieux de stage et les stagiaires. Puisqu’il s’agit du cheminement des étudiants, il leur arrive aussi de devoir assumer une charge émotionnelle découlant de la responsabilité ressentie à l’égard des étudiants et de leur parcours académique. À nouveau, ce travail d’accompagnement est malheureusement peu reconnu. Bien que certains suivis de stage soient dégrevés en bloc, à raison de six crédits pour tous les stages (peu importe le nombre d’étudiants), d’autres professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s ne peuvent faire reconnaître qu’un seul crédit par étudiant.
Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s proposent plusieurs formules pédagogiques, précisément parce que leur objectif n’est pas uniquement celui de transmettre un savoir. Ils doivent amener les étudiants à intégrer les raisonnements, les méthodes et les concepts. Ainsi, les classes se composent de cours magistraux, mais aussi de tables rondes, de discussions, de travaux pratiques, de simulations, d’études de cas ou de sorties extra muros. Une grande partie de ces activités ont pour objectif d’approfondir des idées et de mieux les intégrer. D’autres ont pour priorité la mise en pratique de plusieurs concepts et procédés. Les simulations, les études de cas et tout le travail en laboratoire, par exemple, répondent directement à la nécessité de faire le pont entre la théorie et la pratique. Or, ces activités demandent une très grande préparation parce qu’il faut donner aux étudiants tous les outils pour approcher la même matière par leurs propres moyens. Dans certains cas, il faut créer des travaux dirigés qui sont animés par d’autres services, hors du département et pour qui il faut tout préparer. Cela nécessite également de se conformer à d’autres contraintes, comme le protocole sur l’utilisation sécuritaire des laboratoires, le partage de ces espaces, la formation sur les matières dangereuses et la biosécurité, ou encore l’obtention d’un certificat d’éthique, nécessaire lorsque l’on mène une recherche sur des sujets humains. Dans ce dernier cas, notre membre a tenté une alternative. «Pour la première fois cette année, j’ai décidé que mes étudiant.e.s n’allaient pas effectuer une vraie collecte des données (à leur grande déception), mais ont plutôt travaillé à partir de fichiers de données fictifs. Ceci dit, de préparer ces fichiers de données m’a demandé autant de travail que de soumettre une demande d’éthique.»
Malheureusement, les laboratoires demandent une préparation très intensive et qui n’est certainement pas la même que celle des cours magistraux et ils ne sont pas pondérés comme une charge de cours normale. Un.e membre explique que sa charge habituelle est de six heures de cours par semaines et 3 heures de laboratoire. Cependant, «à chaque quatre semestres, j’ai un cours supplémentaire en raison de la pondération des labos (donc neuf heures de cours + trois heures de labo par semaine).»
Le manque de valorisation des laboratoires donne l’impression que les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s n’ont pas tout le soutien qu’ils méritent pour amener les étudiants à faire le lien entre ce qu’ils apprennent en classe et comment ils peuvent le mettre en pratique.
Mythe 4 : Les professeur.e.s universitaires et les professionnel.le.s enseignant.e.s ont beaucoup de temps libre
Réalité : Un travail en coulisses
Le travail universitaire à l’USB s’effectue dans un contexte absolument unique. En effet, avec une équipe d’environ soixante professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s permanent.e.s pour l’USB, toutes les tâches reposent sur un nombre très réduit de personnes. Les départements ou les écoles se composent de quelques membres à peine. Un.e ou deux professeur.e.s sont responsables de l’enseignement de toute une discipline, et viennent se rajouter à des tâches administratives et extracurriculaires.
C’est aussi toute l’administration ou la direction de certains programmes qui incombe à nos professeur.e.s et nos professionnel.le.s enseignant.e.s. Les tâches varient du recrutement de nouveaux étudiants, à la sélection des candidats, au suivi avec le registrariat ou le doyen, la coordination de stages ou la gestion des disputes entre étudiants ou collègues. C’est un travail qui est tantôt ignoré, tantôt compensé par un dégrèvement (une décharge d’enseignement) de trois ou six crédits.
Parce qu’il y a trop peu de personnes pour dispenser toute la matière, la charge d’enseignement augmente. Les professeur.e.s réguliers.ères ont une charge de 18 crédits (3 cours par session, 6 cours par an) et les professionnel.le.s enseignant.e.s donnent 7 cours. Puisqu’il est difficile de trouver un personnel qualifié (et francophone) capable de dispenser l’enseignement, certains de nos membres à ont dû assumer une surcharge et enseigner parfois jusqu’à 24 crédits sur une année. Il est à noter que les autres universités ont des charges d’enseignement beaucoup plus légères. De plus, dans notre université, chaque professeur.e doit s’assurer avec un.e collègue ou parfois seul.e les cours nécessaires à la réalisation d’une majeure ou d’une mineure. Par conséquent, il n’y a que très peu de marge de manœuvre et il faut respecter une rotation de cours bien définie.
Mythe 5 : L’enseignement en français, c’est facile quand on est francophone
Réalité : Adapter les ressources à nos besoins
Les ressources pédagogiques ne sont pas forcément adaptées à nos étudiants. Par exemple, pour compenser le manque de formation à la recherche, un.e professeur.e a préparé un guide d’utilisation d’un logiciel, comprenant de nombreuses captures d’écran pour permettre aux étudiants de faire une analyse de données de recherche en dehors des heures de laboratoire. C’est de plus un guide qu’il faut mettre à jour, à chaque fois que le logiciel publie une nouvelle version.
Un.e autre membre doit parfois compenser le caractère peu adapté des manuels à disposition. «La majorité des livres et ressources en ligne sont en anglais, ou bien sont des textes de la France qui sont trop avancés pour nos étudiants, ou bien sont des traductions qui ne sont pas récentes. Avec des textes uniquement en anglais, si on utilise les figures, il faut les traduire. Il est très difficile de trouver des vidéos en français, même pour des processus de base. » Le travail de traduction et d’adaptation revient donc souvent au.x professeur.e.s et aux professionnel.le.s enseignant.e.s qui sont les seuls à comprendre concrètement les défis d’enseigner à une population étudiante venant à la fois de l’immersion, du système scolaire francophone et de l’international.
Conclusions
Tous ces efforts ne sont pas vains, bien au contraire. Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s ont vraiment à cœur la réussite de leurs étudiants et en « dépit de cette surcharge de travail,» ils et elles «s’efforcent de donner la meilleure formation possible à leurs étudiants» et «peuvent constater les progrès.» C’est le cas lorsqu’ils sont capables de faire des liens avec d’autres cours, avec ce qu’ils ont déjà appris ou lorsqu’ils posent des questions qui démontrent une certaine réflexion. On le constate aussi lorsque les étudiant.e.s participent de manière active et s’investissent dans les travaux. Les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s constatent aussi que les étudiant.e.s se sont rendu compte qu’ils et elles ont reçu une formation de très grande qualité. Au travers de leurs commentaires ou de leur parcours professionnel par la suite, on peut voir que notre enseignement a eu un impact. Mais c’est au prix d’un nombre considérable d’heures supplémentaires et au risque d’épuisement professionnel de la part de leurs professeur.e.s et professionnel.le.s enseignant.e.s.
La charge de travail qui ne fait que croître d’année en année n’est plus soutenable pour un enseignement de qualité malgré tout l’appui offert par les équipes administratives, l’entretien, l’informatique, le Service de perfectionnement linguistique, le Centre de tutorat et surtout la bibliothèque qui eux-mêmes disposent de ressources limitées.
On ne peut que s’imaginer quelle serait la qualité de la formation offerte aux étudiants si les professeur.e.s et les professionnel.le.s enseignant.e.s pouvaient se concentrer sur un enseignement de qualité, en disposant du temps nécessaire à une préparation et à un suivi adéquats, d’une reconnaissance du travail investi par des heures-crédits et par un plus grand soutien dans l’administration des programmes. C’est la qualité plutôt que la quantité de l’enseignement qui assurerait une bonne formation de la relève.
University education: myths and realities
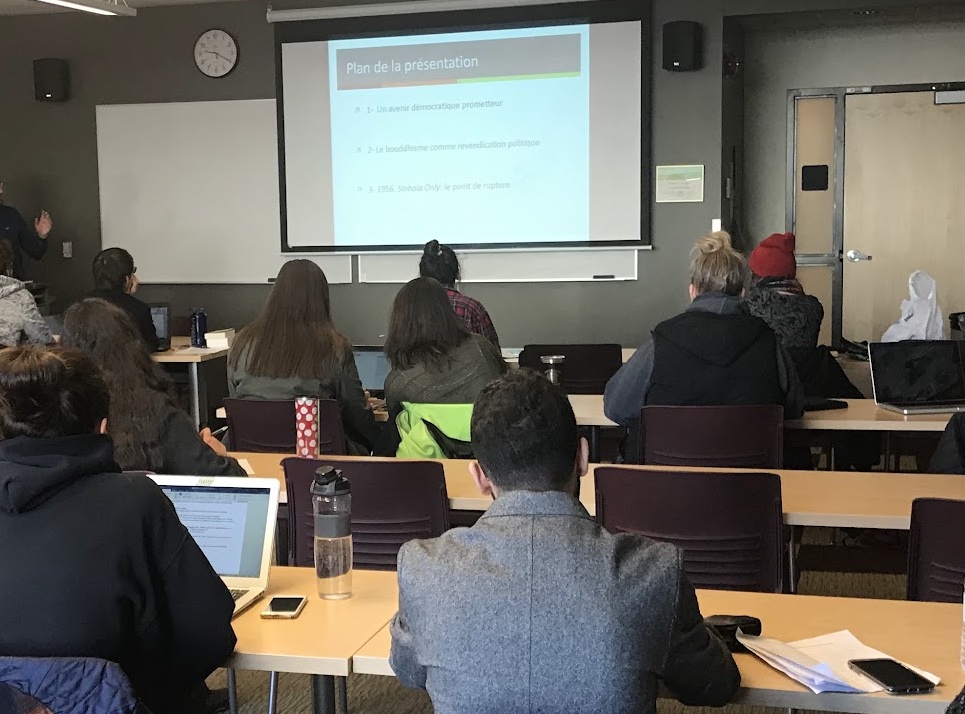
Often perceived as locked away in their ivory towers, with minimal presence in the classroom, the work of university professors is little-known, often misunderstood and sometimes even devalued. The APPUSB is publishing a series of posts explaining the three components of a professor’s job: research, teaching and service, with the aim of better understanding the scope of a professor’s work.
APPUSB went to meet several professors and teaching faculty from several disciplines (biology, chemistry, education, French, history, psychology, social work) to gain a better understanding of the work involved in postsecondary teaching. Far from an exhaustive study of all its members, this overview enables us to grasp the range of tasks that lie beneath a simple teaching load.
Part one
University education: myths and realities
Myth 1: University professors and teaching professionals teach a slightly more complicated version of what is being taught in high school.
Reality: Offering cutting-edge teaching
Unlike high school, where the curriculum is set by the province, teachers and teaching professionals have to put together courses and even programs from scratch. In fact, it’s up to each of them to determine the subject matter, objectives, framework and pedagogical approach of their courses.
This freedom does not mean that teachers and teaching professionals have every right. Academic freedom, i.e. the guarantee of freedom from interference in university teaching, is as much a privilege as it is a responsibility, and ultimately an obligation to keep one’s expertise up to date: “My discipline is a very fertile field of research where knowledge evolves rapidly,” confides one member. « Often, you have to update the course and use current examples. So, you have to stay up to date in the field, » explains another. Professors and teaching professionals have to constantly adapt course content to provide students with the most up-to-date training possible.
There is another major difference between university and secondary education. “In my opinion, training our students to conduct research projects is an integral part of the teaching duties of a university professor.” Thus, courses at university level don’t just offer content to be understood and memorized. They train students in critical thinking and skills to familiarize them with research processes, engage with the literature and current debates, assess various methodologies, experiment protocols or the dissemination of its results. For example, they learn to conduct exhaustive and effective documentary research in data banks, to question the credibility of information sources, to develop their critical analysis and synthesis skills, to draw up a good writing plan, to write in academic language, to present and defend a proposal, and so on.
Professors and teaching professionals offer students all the tools they need to better understand, in each of their disciplines, that science is a form knowledge that is constructed, disputed and debated, over decades or hundreds of years. University education differs from high school in that it familiarizes students with the processes involved in the creation and transmission of scientific knowledge, which will enable them, in turn, to approach their profession with a critical eye, and help them innovate in the future.
Myth 2: University professors and teaching professionals work very little because they don’t spend a lot of time in the classroom
Reality: Courses require intensive preparation and follow-up
A three-credit course consists of two 1.5-hour sessions or one 3-hour session each week, which does not seem very much. As the normal teaching load is between 18 and 21 university credits per year, each professor and teaching professional spends from 9 to 11 hours in the classroom per week.
Depending on the discipline, each one-and-a-half-hour lesson requires around four hours preparation, and this doesn’t take into account course set-up, administrative work or corrections.
Behind each class, professors and teaching professionals are also involved in the programming, creation, administration and supervision of classes. Indeed, they often inherit various baccalaureate courses that they must constantly update. Since the USB is attached to the University of Manitoba (UofM), changes on their side have an impact on those of the USB. Likewise, professors and teaching professionals who want to completely revamp course offerings and requirements to graduate must do so while respecting UofM’s criteria: « I had the task of presenting new course proposals to my colleagues at the University of Manitoba, and following up with them to gain their support for the creation of these courses.”
Moreover, professors and teaching professionals have to teach subjects that are sometimes very different from their area of specialization. This requires extensive preparation. Indeed, they don’t just give basic instruction, but need to have a significant understanding of the field to be able to distinguish what is important, which consensus has been established from what’s still hotly contested. It is essential to master the subject to be able to teach it. This preparatory work is intensive and is becoming increasingly so for teachers and teaching professionals. « I have several colleagues in the United States who teach more hours every week than I do. But, if they teach a 4-4, for example, it’s systematically the same courses every year, and most of them are the same courses taught in several sections. I’ve yet to meet a colleague outside USB who has had to prepare eleven to twelve new classes in just three or four years, » explains one member.
Another challenge is that some courses are only taught every two or three years. “So we have to reassess the content each time, and we have to update the material in line with emerging research in the field.” The process of continual creation and updating has an impact on other duties of the work of professors and teaching professionals. Indeed, those who teach a wide variety of courses ultimately have very few means of gaining recognition for this extra work. Their productivity in terms of research and service is often judged to be on a par with colleagues whose teaching load or scope is perhaps less substantial.
Accounting for preparation, updating, supervision and correction, the time devoted to teaching for a 9-credit-per-week load ranges from 35 to 45h/week according to our respondents. In fact, it’s a full-time job that requires extra hours during busy periods of the semester. All this, of course, ignores the fact that teaching is only one of several duties of teaching professionals and professors. For the former, it may be another teaching load on top of their involvement in service, and for the latter, their work in service and of course, research. These are all extra hours added to their working week.
Myth 3: University education is abstract and useless
Reality: Education adapted to today’s and tomorrow’s society
In many university disciplines, professors and teaching professionals have to plan internships: the workload associated with planning, supervising and assessing internships is substantial. The requirements vary from one discipline to another, but the difficulty of the internship lies precisely in matching the employers’ interests with the student’s training objectives. Professors and teaching professionals therefore need to engage in a dynamic correspondence, draft contracts, organize visits, assess the practical experience gained, and grant accommodations to meet all these expectations. “If all goes well, it’s a minimum of one monthly visit (three hours), one 30-minute meeting per week, assessments and feedbacks for a minimum of three hours per week per student, from August to the end of March,” explains one member. Another professor adds: « We’re never completely on vacation. We always have to respond to students and internship supervisors. » It should also be noted that professors and teaching professionals are not only responsible for creating synergy between employers and interns. Since they are responsible for the students’ progress, they may also have to take on an emotional burden because they feel responsible for the students and their academic careers. Once again, any supervision involves a complex work which is often misunderstood. While some professors receive a full teaching release to supervise internships, that is, six credits for all of them (regardless of the number of interns), other professors and teaching professionals only receive one credit per student supervised.
Professors and teaching professionals also offer a wide range of pedagogical approaches, because their purpose is not just to transfer knowledge. They want students to think for themselves, understand intellectual processes, methods, and concepts. Classes are made up of lectures, round tables, discussions, practical work, simulations, case studies and experiences outside of the classroom. Many of these activities provide an opportunity to gain a deeper understanding of key ideas. Others offer a practical application of various concepts and processes. Simulations, case studies, and laboratory work, for example, directly address the need to bridge the gap between theory and practice. But these activities require a great deal of preparation, because students must be given all the tools they need to approach the same subject on their own. In some cases, we have to create the material for classes and workshops that are taught by other units, outside the department and for whom every single detail must be covered. This also requires compliance with other constraints, such as the laboratory use safety protocol, sharing of laboratory space, training in hazardous materials and biosafety, or obtaining an ethics certificate, which is necessary in any research on human subjects. In the latter case, our member tried an alternative. « For the first time this year, I decided that my students were not going to carry out real data collection (much to their disappointment), but instead worked from fictitious data files. That said, preparing these data files took as much work as submitting an ethics application. »
Unfortunately, laboratories require very intensive preparation, which is certainly not the same as for lectures. They are not weighted as a normal course load. One member explains that her usual load is six hours of lectures per week and 3 hours of laboratory. However, “every four semesters, I have an extra course because of the weighting of the labs (so nine hours of lectures + three hours of lab per week).”
The lack of emphasis on labs gives the impression that professors and teaching professionals don’t get the support they need to help students make the connection between what they learn in class and how it applies in practice.
Myth 4: University professors and teaching professionals have a lot of free time
Reality: A substantial work behind-the-scene
University work at USB takes place in a unique context. In fact, with a team of around sixty professors and the USB’s permanent teaching professionals, all tasks are carried out by a very small number of people. Departments and schools are made up of just a few members. One or two professors are responsible for teaching an entire discipline, in addition to administrative and extra-curricular tasks.
Our professors and teaching professionals are also responsible for the administration and direction of certain programs. Tasks range from recruiting new students, selecting candidates, following up with the registrar or dean, coordinating internships or managing disputes between students or colleagues. It’s a job that’s sometimes ignored, sometimes compensated by a three- or six-credit teaching discharge. Since very few people have to teach many subjects, the teaching load increases. Regular professors have a charge of 18 credits (3 courses per session, 6 courses per year) and teaching professionals are responsible for 7 classes. As it is difficult to find qualified (and francophone) faculty capable of teaching, some of our members have had to take extra classes and sometimes teach up to 24 credits in a year. It should be noted that other universities have much lighter teaching loads. Moreover, in our university, a single professor and sometimes two are entirely responsible to teach the necessary courses for the completion of a major or minor. Therefore, there is very little room for manoeuvre and professors and teaching professionals must respect a specific course rotation.
Myth 5: Teaching in French is easy when it is your native language
Reality: Adapting resources to the students’ needs
Teaching resources are not necessarily adapted to our students. For example, to compensate for the lack of research training, one professor has prepared a guide to help students use a software program, including numerous screenshots to enable students to analyze research data outside laboratory hours. Besides, this guide has to be updated every time the software releases a new version.
Another member sometimes has to adapt existing textbooks which are not entirely suitable to our students. « The majority of books and online resources are either in English, texts from France that are too advanced for our students, or very old translations. With English-only texts, any figure used needs to be translated. It’s very difficult to find videos in French, even for basic processes. » Professors and teaching professionals therefore need to adapt the material because they are the only ones who understand what it takes to teach to students who come from abroad, the French school division, or immersion.
Conclusion
All these efforts are not in vain. In fact professors and teaching professionals put a priority on their students’ success. “Despite this work overload,” they “strive to give their students the best possible training” and “can see progress.” Such success happens every day. Students make connections with previous learning or other courses. They show critical thinking and ask tough questions. This is also the case when students actively participate in discussions and engage with research projects. Students know that they have been trained with the greatest care. Students’ various career paths and words of encouragement are a testimony that our teaching has a positive impact. But it comes at a considerable cost, with several hours working overtime, and the constant risk of professional burnout.
The workload, which only increases year after year, is no longer sustainable to maintain teaching excellence, despite all the support offered by the administrative teams, maintenance, IT, the Language Development Service, the Tutoring Centre and above all the library, which all have limited resources.
We can only imagine what USB would be if professors and teaching professionals could provide quality teaching. This would require time for adequate preparation and follow-up, recognition of the work invested through credit hours, and greater support in program administration. The quality and not the quantity of teaching is key for the success of the next generation.

